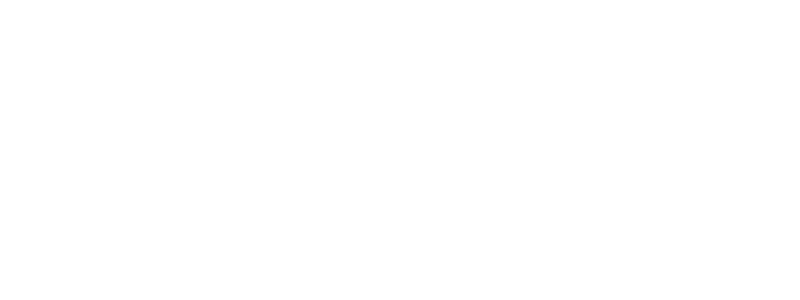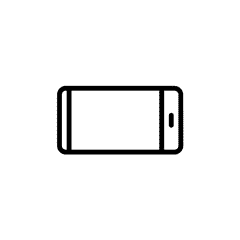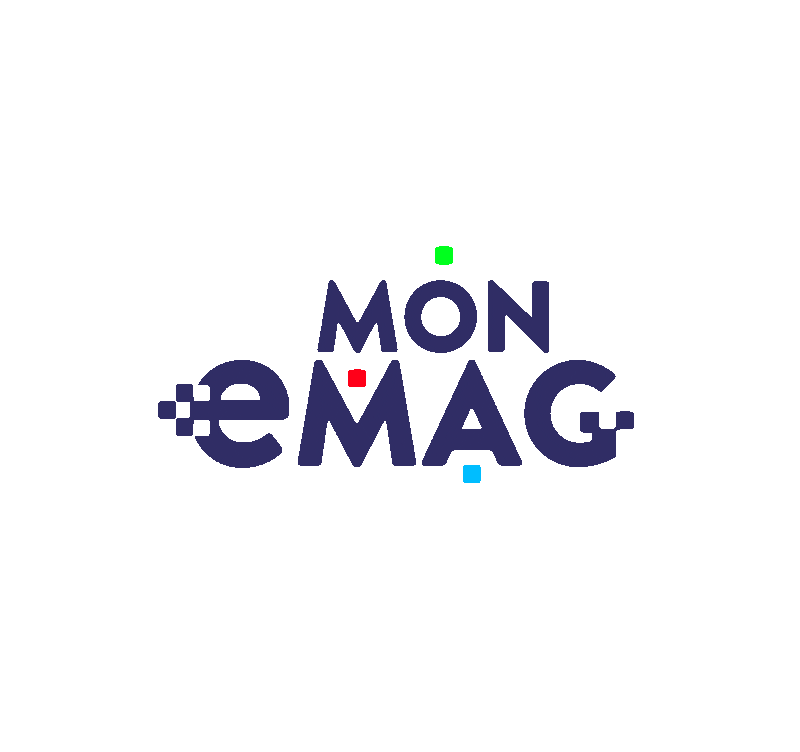Après-midi piscine
En voyage, Kafka commençait toujours par demander où aller nager. Il était manifestement convaincu qu’on ne pouvait faire corps avec un lieu qu’en se baignant dans ses eaux. J’ignore ce que la psychanalyse penserait de son rapport à la mer, mais toujours est-il que j’avais pris l’habitude d’en faire autant, et ne comptais plus le nombre de villes transitoires miraculeusement réanoblies par la beauté de leurs bassins municipaux – parmi lesquelles Le Havre, Rennes, ou Bruay-la-Buissière. Aucun n’exerçait toutefois un pouvoir d’attraction équivalent à celui du Cercle, dont la consécration de membre était un délicieux chemin de croix, nécessitant d’en passer par une double cooptation – devant attester sur dossier d’une ancienneté quinquennale –, et par un écot conséquent à verser chaque printemps. Mais, pour tout Marseillais appartenant ou aspirant à la haute, il fallait « en être », et chacun semblait avoir ses propres raisons, sans jamais devoir en justifier. On y croisait des êtres comme tout droit sortis de l’Odyssée, de ceux que l’on ne voyait étonnamment jamais en ville. Des Apollons aux silhouettes en V majuscule, des nymphes aux attaches fines comme des lustres de Murano, de vieux sages à la peau délicatement parcheminée, des chérubins nourris au lait entier.
Le Cercle avait des allures de vaisseau résolument à part, se faisant chaque jour le théâtre de petits drames, de scènes de gymnastique aux confins de l’absurde, de plongeons plus ou moins torsadés, d’exhibitionnisme glabre, que même un improbable conflit mondial ne saurait venir interrompre. Chaque recoin, chaque coursive, chaque cabine cadenassée, participaient d’une scénographie rassurante, et inlassablement renouvelée. Aux baigneurs disciplinés de l’aube succédaient sur les coups de midi les familles rassemblées sur trois générations, dans une ambiance de steak-frites et de crème solaire, de hurlements d’enfants réclamant leur Calipo, exhibant en fin d’après-midi leur butin de coquillages nacrés comme une précieuse collection de bijoux. J’y avais développé au fil des mois un grand intérêt pour le minuscule, et pouvait passer des heures entières sur la terrasse à regarder mollement le fond de la piscine, retardant non sans un certain plaisir le moment du premier bain, mais surtout cette parenthèse bénie du passage aux vestiaires. C’était un lieu-parenthèse, de féminité mise à nue, humide comme un mois d’août aux îles Salomon, où régnait une odeur de shampoing, de serviette chaude, de chlore et de produit pour carrelage. Une antichambre préservée de l’extérieur, qui prenait chaque jour par flux inconstants des allures de gynécée plus ou moins tapageur. J’y observais avec une dévotion furieuse cet enchevêtrement tendre et cruel de peaux lâches, tendues, rasées, ou en cours de repousse, traversé d’un camaïeu de carnations allant du diaphane au bitume, en passant par le bronze, le caramel et l’abricot.
J’éprouvais toujours une certaine peine à en sortir, saisie par la brusque appréhension du contact de l’eau froide au bas de l’aine, de la concurrence déloyale des crawleurs patentés, et de ce vague ennui qui vous saisit après la vingtième longueur de brasse. Un bassin familier dans lequel je noircissais en pensée des dizaines de pages de romans voués à ne jamais voir le jour, où je résolvais en surface des découverts abyssaux sous formes de tableaux excel imaginaires, avant de me laisser submerger par toute une cohorte de scénario plus ou moins avouables en fonction de l’heure, de la lumière ou du cycle des saisons. Mais il faut bien reconnaître que dès les premiers jours du printemps, j’en ressortais toujours avec les hormones dans une meilleure configuration.
Au fil des années, j’avais fini par y retrouver des visages connus, auxquels je prenais soin de donner des prénoms d’emprunt, souvent issus du calendrier de la Poste, plus rarement des noms d’indiens – un privilège que je réservais aux personnalités les plus discutables, parmi lesquelles une certaine Bison Futé, prise sur le fait en plein rapt de gel douche. J’écoutais les conversations, interprétais les regards en coin, consignais mentalement le moindre détail pour en inventer la signification – une montée en gamme en matière de lingerie ne pouvant être autre chose qu’un aveu d’adultère, un implant mammaire le signe d’un couple sur le déclin, l’achat d’une résidence secondaire le symptôme d’une peur panique de mourir ou de partir en retraite.
Seule l’une d’entre elles parvenait à me résister complètement. Un vendredi de mars, elle avait fait irruption dans les vestiaires sans que je puisse comprendre comment elle avait atterri ici. Aucun maillot ni bonnet réguliers, l’air apeuré ou extatique, parfois flanquée d’une grosse valise vert amande, mais jamais d’une tenue en adéquation avec la météo. Son corps était un champ de bataille. On le sentait noué, friable, presque transparent. Elle posait méthodiquement son téléphone et ses écouteurs sur le rebord du banc le temps du déshabillage, qui se faisait tantôt lent ou frénétique, touchant ses contours face au miroir en commençant par les côtes, qu’elle semblait compter avec la déférence d’un expert-comptable. Je la voyais exécuter ses longueurs, la tête hors de l’eau et la nuque en angle droit, toujours un multiple de 20 selon le temps imparti par on ne sait-qui – mais pas elle, c’était certain –, le sourire vissé aux lèvres ou les larmes aux bords des yeux, parfois les deux. De loin, elle semblait murmurer de petites formules à voix basse, mais je n’ai jamais rien pu lire sur ses lèvres, qu’elle gardait mi-closes afin d’éviter de boire la tasse. Je ne réussissais pas à la nommer, tant elle paraissait simultanément au-dessus de tout et au fond de l’abîme. Elle ne se douchait jamais sur place, séchait à peine ses cheveux qu’elle avait extraordinairement fins, et remontait sur la terrasse fumer une cigarette, le regard pointé vers les hauteurs du bassin olympique.
Elle attendait. Il arrivait généralement quelques minutes plus tard. Le visage fermé, posé sur un amas de muscles si développé que ses avant-bras semblaient flotter en apesanteur à distance du tronc. Son regard passait du bleu pâle au noir laqué, et ne s’adoucissait que lorsqu’il l’apercevait, elle, sursautant de joie comme si elle l’avait cru passé à côté de la mort. Je remarquai progressivement la mise en place d’un petit rituel, toujours le même, qui consistait pour elle à se figer de haut en bas alors qu’il approchait dans sa direction, cessant tout à coup de cligner des yeux, avec cet air d’enfant au beau milieu d’une partie de loup glacé. Lorsqu’il arrivait à sa hauteur, elle prononçait toujours la même phrase : « Je suis paralysée ». Il éclatait de rire et l’embrassait sur le front, avant de s’asseoir quelques minutes, échanger quelques phrases, parfois des listes de courses prononcées à voix haute, et je les voyais s’éloigner vers la sortie. Il semblait régner entre eux une sorte de tension vorace, d’attachement inquiet, de mélancolie agglutinée en caillots. Une complicité de façade, dense et opaque comme un suicide accompli. Il venait parfois seul, tandis qu’elle disparaissait de longues semaines avant de ressurgir à échéances irrégulières, reproduisant toujours le même petit manège. Au fil des mois, je notai qu’elle passait de plus en plus de temps aux vestiaires, écrivant frénétiquement des messages à on ne sait qui, un homme, peut-être, à voir ses joues s’empourprer soudainement à la moindre vibration. Son regard était de plus en plus absent, ses yeux embués, sa gestuelle proche de celle d’un canard sans tête.
Un tiède après-midi de septembre, je l’aperçu pour la première fois seule sur la terrasse, immobile face à la mer, comme figée dans un faisceau de nacre. Le soleil s’étendait sur ses jambes et dorait légèrement la bourre d’un manteau gris tendre. Je décidai de m’asseoir à quelques mètres, et j’en étais presque à faire claquer ma serviette d’un coup sec dans sa direction, comme on tenterait de faire sursauter un vulgaire pigeon. Elle pleurait. J’ignore si elle avait remarqué ma présence, et nous sommes restées de longues minutes côte à côte, dans un silence vide et parfait, de ceux auxquels on s’abandonne sans résistance. Le matin même, sur les coups de 7h30, j’avais entendu à la radio qu’il existait un syndrome du cœur brisé, que l’on appelait au Japon le « Tsako-tsubo ». Un phénomène que l’on pouvait traduire en français par « Piège à poulpe », et qui désignait la forme que prenait le ventricule gauche du cœur sous l’effet d’une libération massive d’hormones de stress, causée par un choc émotionnel. Je n’avais pas eu le courage d’écouter la fin de l’émission. Mais je venais soudainement de comprendre que j’avais à mes côtés une femme qui n’était déjà plus là depuis longtemps. Elle avait fini par tourner la tête, m’avait regardée droit dans les yeux, et m’avait adressé un léger sourire en posant la main sur son sein à l’endroit du cœur, avant d’emprunter l’escalier menant vers la plage. Elle s’était déshabillée lentement avant d’entrer dans l’eau, s’éloignant de la rive jusqu’à n’être plus qu’un petit point noir brisant la ligne claire de l’horizon. Sur sa chaise, je remarquai qu’un livre était resté ouvert. Le Journal de Kafka, écrit en 1914, où une phrase était soulignée au crayon mine. « Aujourd’hui, l’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine ».